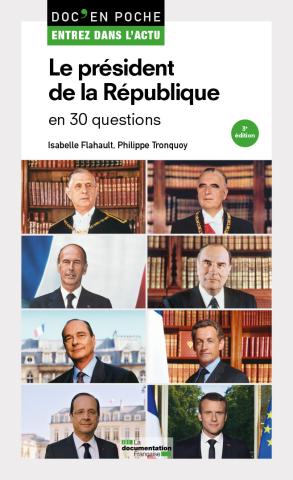Le président de la République : le Président français et les chefs d'État étrangers, une comparaison internationale (1/3)
L’Actualité de la vie publique - podcast - N° 29
Temps de lecture 14 minutes

Les 10 et 24 avril 2022, aura lieu l’élection du président de la République. Notre podcast « L'Actualité de la vie publique » vous propose une nouvelle série consacrée à cet événement majeur de la Ve République. Quel est le rôle du Président français ? Les pouvoirs du Président sont-ils les mêmes dans chaque pays ?

Le président de la République : le Président français et les chefs d'État étrangers, une comparaison internationale (1/3)
[GÉNÉRIQUE]
Vous écoutez L’Actualité de la vie publique, un podcast du site Vie-publique.fr.
Signature sonore
Stéphanie : Bonjour à tous, bonjour Chloé
Chloé : Bonjour Stéphanie
Introduction de la série
Stéphanie : Les 10 et 24 avril 2022, aura lieu l’élection du président de la République. A cette occasion, notre podcast L’Actualité de la vie publique vous propose une nouvelle série consacrée à cet événement majeur de la Ve République.
Comme tous les cinq ans, pas moins d’une dizaine de candidats sont en lice pour occuper la plus haute fonction de l’État. Notre série de trois épisodes, vous aidera à mieux comprendre le rôle et les différences qui existent entre le président français et les chefs d’État dans d’autres pays. Nous vous expliquerons aussi comment la fonction présidentielle a évolué depuis son origine. Et pour finir, nous nous intéresserons à un aspect très important de l’élection : le coût d’une campagne présidentielle.
Au sommaire de ce premier épisode : "Le rôle et les pouvoirs du président de la République : une comparaison internationale".
1. Stéphanie : Pour répondre à nos questions, nous avons invité Chloé, étudiante en science politique, qui a déjà participé à notre série sur l’Europe. Première question, Chloé, quelle est la place du président de la République dans les institutions de la Ve République ?
Chloé : C’est très simple ! La présidence de la République est la fonction politique la plus importante en France. C’est le Président qui exerce les plus hautes fonctions du pouvoir exécutif. Il occupe une place de tout premier plan au sein de la Constitution. Pour employer une image, on peut dire que la fonction présidentielle est la "clé de voûte de notre régime politique".
[Intervention Stéphanie : Et d’où tire-t-il sa légitimité Chloé ?]
Chloé : Sa légitimité lui vient de la Constitution et du suffrage universel – qui renforce cette légitimité – le Président est élu tous les cinq ans directement par le peuple.
2. Stéphanie : Comment la Constitution définit-elle précisément le rôle du président de la République ?
Chloé : Le président de la République incarne l’autorité de l’État. Il dispose de ce fait d’importants pouvoirs. Voici comment la Constitution définit son rôle, je cite : "Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités", je ferme les guillemets. Le Président est donc chef de l’État mais également chef des armées.
[Intervention Stéphanie : La politique étrangère et la diplomatie font également partie des attributions du président de la République, n’est-ce pas ?]
Chloé : Absolument il a la haute main sur la politique étrangère du pays. Il participe aux grandes négociations internationales ou les grands sommets internationaux réunissant les principaux chefs d’État et de gouvernement de la planète comme le G7, le G20 ou les conférences sur le climat.
[Intervention Stéphanie : Et quel est son rôle dans le domaine de la justice ?]
Chloé : Le Président est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est aidé dans sa tâche par le Conseil supérieur de la magistrature qui répond aux demandes d’avis émises par le président concernant les affaires relevant de la justice.
[Intervention Stéphanie : Le président de la République est-il responsable de ses actes ?]
Chloé : Le Président n’est pas responsable des actes qu’il accomplit en sa qualité de président de la République. Il bénéficie en effet d’une immunité pour les actions entreprises dans l’exercice de son mandat. Cela signifie que pour toutes les décisions qu’il aura prises durant son mandat, il ne risque aucune action à son encontre devant un tribunal français après la fin de ses fonctions de Président mais il peut être poursuivi par la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité. Cette protection s’applique pendant et après son mandat, sauf si le Président "manque à ses devoirs" et commet des actes incompatibles avec l’exercice de sa fonction. Depuis la réforme constitutionnelle de 2007, le Président peut, en effet, être destitué.
[Intervention Stéphanie : Pour quelles raisons le Président peut-il être destitué ?]
Chloé : La procédure de destitution peut porter sur son comportement politique (par exemple s’il ne respecte pas la Constitution) ou privé (s’il se rend coupable d’un acte extrêmement grave comme un crime par exemple). Mais attention la destitution est une sanction politique, et non pénale. Cette procédure est de plus très encadrée afin d’empêcher toute manœuvre politique du Parlement contre le Président.
[Intervention Stéphanie : Mais pour des actes incompatibles avec l’exercice de sa fonction, il ne peut pas être poursuivi par la justice pendant son mandat, n’est-ce pas ?]
Chloé : Concernant les actes qui ne sont pas liés à sa fonction de président de la République et qui pourraient lui valoir des poursuites judiciaires, il est en effet protégé durant son mandat : c’est-à-dire qu’il ne peut pas être poursuivi par la justice, ni être obligé de témoigner devant un tribunal. On dit que le président de la République est "inviolable". Mais ce statut est temporaire et cesse après la fin de son mandat. S’il a commis des délits avant ou pendant son mandat, Il peut alors être jugé comme n’importe quel citoyen ordinaire.
3. Stéphanie : Vous nous avez dit Chloé que le président de la République avait en France beaucoup de pouvoirs, c’est-à-dire ?
Chloé : Les pouvoirs du Président sont de deux types : les pouvoirs propres et les pouvoirs partagés.
[Intervention Stéphanie : Alors commençons par les pouvoirs propres !]
Chloé : Les pouvoirs propres sont les pouvoirs qu’il exerce seul, c’est-à-dire sans la signature du Premier ministre qui est le chef du gouvernement ou des ministres. Les pouvoirs propres du Président sont : de nommer le Premier ministre, de soumettre un projet de loi au référendum, d’exercer les pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave (les pouvoirs de crise précisés à l’article 16 de la Constitution comme dans le cas d’une tentative de renversement du pouvoir lors d’un coup d’État), de communiquer avec le Parlement (l’Assemblée nationale et le Sénat), de saisir le Conseil constitutionnel qui est chargé notamment de contrôler que la loi est conforme à la Constitution, d’en nommer trois membres ainsi que son président. Et il a également le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale.
[Intervention Stéphanie : Donc par voie de conséquence, les pouvoirs partagés nécessitent la signature du Premier ministre, n’est-ce pas ?]
Chloé : Oui tout à fait ! A côté des pouvoirs propres, le Président a des pouvoirs partagés, qui nécessitent la signature – on parle de contreseing – du Premier ministre ou des ministres responsables, qui préparent et appliquent des actes du Président. Il peut s’agir concernant le Premier ministre de la nomination des ministres ou de la signature des ordonnances et des décrets.
4. Stéphanie : Et la fonction de président de la République est-elle la même dans tous les régimes politiques Chloé ?
Chloé : Non Stéphanie car le rôle et les pouvoirs du chef de l’État dépendent en fait du type de régime politique adopté par chaque pays.
[Intervention Stéphanie : Rappelez-nous svp les deux régimes politiques que l’on peut trouver dans les démocraties]
Chloé : Dans les démocraties, il existe deux grands types de régime politique : le régime parlementaire comme au Royaume-Uni ou en Italie et le régime présidentiel comme aux États-Unis.
5. Stéphanie : Quelles sont les grandes caractéristiques du régime parlementaire que l’on trouve en Italie ou au Royaume-Uni ?
Chloé : La principale caractéristique du régime parlementaire réside dans la nécessité pour le gouvernement de disposer de la confiance de la majorité parlementaire car le gouvernement est responsable devant celle-ci et doit remettre sa démission s’il ne dispose plus d’une majorité de députés pour le soutenir. Une autre caractéristique très importante de ce régime est la dissociation du pouvoir exécutif entre le chef de l’État et le gouvernement. Le chef de l’État qui peut être un président de la République comme en Italie ou un monarque comme la reine d’Angleterre incarne la continuité de l’État et ne participe pas à l’exercice du pouvoir sauf pour la nomination du chef du gouvernement (le Premier ministre comme au Royaume-Uni ou le Président du Conseil des ministres comme en Italie). Le chef de l’État n’a donc pas dans un régime parlementaire de rôle actif. On dit qu’il est politiquement irresponsable.
[Intervention Stéphanie : C’est donc le chef du gouvernement qui exerce réellement le pouvoir, n’est-ce pas ?]
Chloé : Oui c’est cela ! Le chef du gouvernement et ses ministres assument la conduite de la politique de la Nation sous le contrôle du Parlement. Le gouvernement partage avec le Parlement l’initiative législative (ce qui veut dire qu’il dépose des projets de loi) et participe donc à l’élaboration de la loi. Un pouvoir de dissolution des assemblées - qui entraîne donc l’organisation de nouvelles élections législatives - est reconnu au chef de l’État ou au chef du gouvernement. Ce qui permet de sortir d’une éventuelle situation de blocage dans le cas où le gouvernement perd la confiance de la majorité parlementaire ou doit surmonter de fortes tensions avec celle-ci.
[Intervention Stéphanie : Et qu’en est-il du régime présidentiel ?]
Chloé : Le régime présidentiel a été mis en place aux États-Unis au moment de l’indépendance de la jeune nation américaine à la fin du XVIIIe siècle. Sa caractéristique principale est la stricte séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
[Intervention Stéphanie : Qu’est-ce que cela veut dire ?]
Chloé : Le Parlement – aux États-Unis, c’est le Congrès (Chambre des représentants et Sénat) - a le monopole du pouvoir législatif - ce qui comprend la pleine maîtrise du vote des lois et le monopole de l’initiative législative (c’est-à-dire de proposer des projets de loi). Il a également un important pouvoir de contrôle et d’investigation du fonctionnement des services relevant du pouvoir exécutif.
[Intervention Stéphanie : Et qui détient le pouvoir exécutif ?]
Chloé : Et bien c’est le Président des États-Unis ! Sa légitimité est forte car celle-ci repose sur son élection au suffrage universel. Le Président est à la fois le chef de l’État et le chef du gouvernement. Il a le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres. Il n’est pas responsable politiquement devant les assemblées et ne peut pas être renversé. Mais réciproquement, il n’a pas le pouvoir de les dissoudre et n’a que peu de moyens de les contraindre. Il ne dispose que d’un droit de veto sur les textes législatifs, c’est-à-dire qu’il peut refuser son consentement à un projet de loi adopté par le Congrès (l’assemblée législative). Ce qui a pour effet d’empêcher cette loi d’entrer en vigueur.
[Intervention Stéphanie : La France se situerait donc entre ces deux types de régime politique Chloé]
Chloé : La France se distingue car elle s’est dotée sous la Ve République d’un régime mixte ou semi-présidentiel (on parle aussi de régime présidentiel à la française). Il s’agit d’un régime politique mixte car il emprunte à la fois au régime parlementaire et au régime présidentiel.
[Intervention Stéphanie : Mais alors qu’est-ce qui rapproche la France du régime présidentiel ?]
Chloé : C’est l’élection du Président au suffrage universel, comme aux États-Unis. Le Président français peut également choisir et révoquer les ministres s’il peut s’appuyer sur une majorité au Parlement.
[Intervention Stéphanie : Et qu’est-ce qui rapproche notre pays du régime parlementaire ?]
Chloé : Et bien Stéphanie comme dans un régime parlementaire, le chef du gouvernement (le Premier ministre) est distinct du chef de l’État et sa responsabilité peut être mise en cause par les députés (l’Assemblée nationale). De même comme dans un régime parlementaire, le chef de l’État détient le pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale. Quant au Premier ministre c’est lui qui comme l’indique la Constitution (je cite) "détermine et conduit la politique de la Nation" et "dirige l’action du gouvernement".
[Intervention Stéphanie : Mais comment rendre possible le fonctionnement d’un régime mixte comme celui de la France ?]
Chloé : Le fonctionnement d’un régime mixte n’est possible que si le chef de l’État dispose d’une majorité parlementaire qui le soutient. Si ce n’est pas le cas, alors le régime mixte fonctionne comme un régime parlementaire à part entière. C’est le cas, lors des périodes dites de "cohabitation" entre un président de la République issu d’un camp politique et une majorité issue d’un autre bord politique. Cela a été le cas au milieu des années 1980, un président de gauche – François Mitterrand - cohabitant avec Jacques Chirac, un Premier ministre de droite. Puis à nouveau à la fin des années 1990, mais cette fois dans une configuration inverse, un Président de droite – Jacques Chirac élu en 1995 - cohabitant avec un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin.
[Intervention Stéphanie : Dans le cas d’une cohabitation, c’est donc le Premier ministre qui détient le pouvoir réel, n’est-ce pas ?]
Chloé : Le Président est amené à désigner comme chef du gouvernement, le responsable du parti ayant le plus grand nombre de représentants à l’Assemblée qui dispose lui d’une majorité parlementaire. Le Premier ministre détient dès lors la réalité du pouvoir même si le Président conserve un rôle clé dans les domaines de la politique étrangère et de la défense.
6. Stéphanie : Et en Europe, quel est le régime politique dominant, Chloé ?
Chloé : Au sein de l’Union européenne, les États gardent chacun une organisation politique qui leur est propre. Sur les 27 États membres de l’UE, on compte 6 monarchies constitutionnelles dont le souverain est le chef de l’État mais ne détient plus aucun pouvoir exécutif. Les 21 autres États sont des républiques, qui ont donc un président de la République mais la grande majorité est dotée d’un régime parlementaire. C’est donc le Premier ministre qui est le personnage le plus important et pas le président de la République. Dans 13 États membres, le Président est élu au suffrage universel direct (par les citoyens ayant le droit de vote). Dans les autres pays, l’élection a lieu au suffrage indirect via un collège électoral composé d’élus (députés, sénateurs, etc.). Si en France, le Président est élu pour 5 ans, en Italie et en Irlande, il l’est pour sept ans. Et c’est en Lettonie que la durée de son mandat est la plus courte avec 4 ans.
[Intervention Stéphanie : Ce qui signifie que chez la plupart de nos voisins le Président n’a donc finalement qu’un rôle honorifique ?]
Chloé : Le Président remplit essentiellement des fonctions de représentation et veille au respect des institutions mais il peut néanmoins jouer un rôle déterminant en cas de crise politique grâce à son rôle d’arbitre des équilibres institutionnels comme c’est souvent le cas pour le président de la République italienne. Mais il est vrai que lors des réunions des dirigeants de l’Union européenne à Bruxelles – précisément au Conseil européen qui réunit chefs d’État et de gouvernement – on dénombre seulement 4 présidents et 23 Premier ministres.
Fin de l’épisode
Stéphanie : C’est la fin de cet épisode ! Merci Chloé ! Après ce tour d’horizon très complet, on comprend mieux quel rôle joue le président de la République française et ce qui le distingue de ses homologues à l’étranger.
Au sommaire du prochain épisode : nous nous intéresserons aux origines de la fonction présidentielle et à la manière dont celle-ci a évolué au fil du temps.
Vous pouvez réécouter cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N’hésitez pas à vous y abonner !
Et pour en savoir plus, RDV sur notre site internet Vie-publique.fr et nos réseaux sociaux.
On se retrouve très bientôt ! Au revoir Chloé, au revoir à tous !
Chloé : Au revoir et à bientôt !