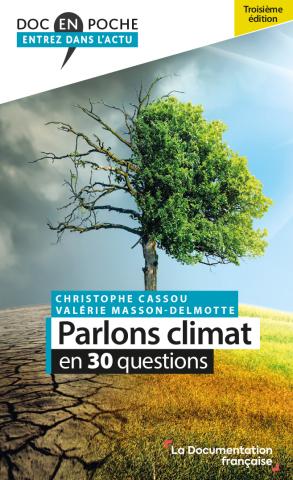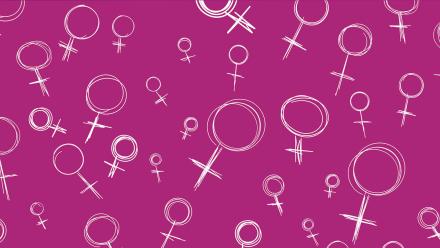En 2023, affirmer que le numérique se situe au cœur de nos modèles économiques et de nos sociétés relèverait presque du truisme tant il a su, en seulement quelques années, se rendre indispensable. Facteur indéniable de croissance et de productivité, vecteur de nouveaux usages à propagation ultra-rapide dans la population, le numérique engage l’ensemble des entreprises et administrations, et à travers elles, toute la société, dans un immense chantier de transformation : transformation des modèles économiques, des modes de production et d’organisation, des systèmes d’information, mais aussi des facteurs de compétitivité, des compétences requises sur le marché du travail et des standards de marché… alimentant un grand ballet de destruction créatrice.
À l’ombre des géants du numérique américains (les GAFAM et autres NATU), ou chinois (les BATX), la France a su tirer profit de cette transition numérique, et à travers elle, du capitalisme numérique qui a accompagné ce mouvement. La French Tech est dynamique et attractive, comme en témoigne un nombre croissant de licornes, ou des investissements étrangers en hausse dans le domaine de la R-D et de la tech. Notre pays bénéficie notamment d’infrastructures de grande qualité, d’un outil d’attraction fiscale de premier ordre avec le crédit d'impôt recherche (CIR), mais aussi d’un savoir-faire reconnu dans le domaine et d’une forte acculturation de la population au numérique qui fait de la France un débouché de premier choix pour nombre de services numériques étrangers. Cela se traduit indéniablement en termes de croissance, d’emploi, d’investissement et de fiscalité.
Cependant, ce capitalisme numérique interroge quant à sa soutenabilité. Au fur et à mesure de la propagation des terminaux et usages numériques à l’échelle planétaire, nous prenons peu à peu conscience de son empreinte environnementale, de ses besoins énergétiques, tout autant que certaines de ses conséquences sociales. Dans un XXIe siècle qui aura pour marqueurs structurels la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources naturelles (mais aussi la course au contrôle des gisements de ressources critiques) et la transition énergétique, l’inquiétude autour de l’empreinte environnementale du numérique est parfaitement légitime.
Dopage métallique, voracité énergétique et nouvelles dépendances : le côté obscur de la force numérique
Selon l’étude Ademe-Arcep de janvier 2022, le numérique représenterait déjà 2,5% de l’empreinte carbone de la France. Bien que les recherches scientifiques pluridisciplinaires visant à mesurer l’impact environnemental du numérique n’en soient qu’à leurs balbutiements, et que les méthodes tout comme les résultats sont encore sujets à caution (nous y reviendrons), un premier consensus semble émerger quant aux deux grandes sources émettrices de pollution numérique.
Celle qui vient premièrement à l’esprit concerne l’énergie nécessaire à l’alimentation de nos équipements numériques, mais aussi des infrastructures, des algorithmes et capacités de calcul sur lesquels reposent les applications et logiciels. En France, le numérique représenterait ainsi déjà près de 10% de notre consommation énergétique (contre 6% au niveau mondial). En principe, notre pays, qui bénéficie d’un mix énergétique peu carboné et qui est structurellement exportateur d’électricité, n’est que peu concerné par ce versant de la pollution numérique. Il faut toutefois nous inquiéter de la progression spectaculaire de la consommation d’électricité directement imputable à la progression du numérique dans notre société (la plupart des projections actuelles tablent sur un doublement à horizon 2030) car, sauf à se mettre en capacité de produire une énergie abondante, bon marché et décarbonée, cela pourrait contribuer au renchérissement de l’électricité, mais aussi à des arbitrages douloureux liés à une demande devenue excédentaire à l’offre.
Mais il convient surtout de considérer l’impact matériel du numérique. Car si les services sont "dématérialisés", ils reposent sur des équipements physiques : des terminaux d’accès, des serveurs distants, des capteurs et autres objets connectés, des réseaux de communication… Ces milliards d’objets (inter)connectés représenteraient, selon les différents rapports, environ 70% de la pollution numérique d’un pays comme la France, qui importe donc massivement cette pollution des pays où ces équipements sont produits (à raison, selon l’Ademe, d’un million de tonnes de ressources par an et par personne).
Au-delà de la consommation énergétique liée à leur alimentation, les équipements numériques ont une empreinte environnementale qui s’explique en effet très largement par les quantités colossales d’énergie carbonée (et de produits chimiques polluants pouvant contaminer les eaux et les sols) qu’il a fallu dépenser pour extraire les métaux nécessaires à leur fabrication, mais aussi pour les opérations de raffinage sans lesquelles nulle exploitation industrielle n’est possible. Le tout avec un rendement énergétique parfois très faible puisqu’il faut, par exemple, traiter une tonne de minerai pour obtenir 1 gramme d’or (c’était 2,5 grammes dans les années 1990)… Or, un objet aussi commun qu’un téléphone mobile de nouvelle génération contient environ 50 métaux (dont du cuivre, de l’or, du cobalt, du nickel, du lithium…), deux fois plus que leur équivalent d’ancienne génération.
Le numérique va ainsi de pair avec l’électrification de la société, laquelle ne se conçoit pas sans un "dopage métallique" qui nous soumet à de nouvelles dépendances :
- sur le plan géostratégique, nous devenons dépendants de pays et d’entreprises étrangers qui maîtrisent l’extraction et le raffinage de ces métaux au fort niveau de criticité, car peu contournables dans l’alimentation de nos activités industrielles stratégiques ;
- sur le plan économique, nous sommes "preneurs de prix" (c’est-à-dire que nous devons accepter les prix imposés sur les marchés) pour ces métaux que nous importons massivement et sans lesquels nos industries sont à l’arrêt. La compétition pour ces ressources, leur raréfaction relative, et le renchérissement des coûts liés à leur extraction et raffinage, ne peut que laisser présager une inflation ;
- sur le plan environnemental, nous dépendons de la nature de l’énergie – aujourd’hui quasi exclusivement fossile et donc fortement émettrice – employée pour alimenter les activités d’extraction et de raffinage. Car si la pollution des sols est locale, le réchauffement imputable aux émissions de gaz à effet de serre (GES), tout autant que ses conséquences, sont planétaires. À ce sujet, le numérique pourrait représenter 7% des émissions françaises de GES à horizon 2040.
Numérique et environnement : une relation complexe et des impacts difficilement mesurables
Comme nous venons de le voir, il n’est plus l’heure de nier l’impact environnemental du numérique, pas plus que les nouvelles dépendances auxquelles il nous soumet. La posture opposée qui consisterait à restreindre aveuglément l’accès aux équipements et aux services numériques serait un non-sens tout aussi préjudiciable, dans la mesure où cela obérerait notre capacité d’innovation, notre productivité, et nous amènerait à renoncer à la croissance et aux emplois (directement et indirectement) liés au numérique que nous avons évoqués en introduction. En d’autres termes, il ne revient pas de sacrifier le numérique sur l’autel de l’environnement, mais plutôt de mettre le numérique au service du progrès économique et social, mais aussi environnemental.
Il faut bien comprendre que le numérique est cette technologie qui peut, lorsqu’elle est mobilisée à bon escient, apporter une contribution décisive dans la lutte contre la pollution. C’est par exemple grâce au numérique que nous sommes en mesure d’optimiser les flux logistiques, de piloter les capacités de production ou de stockage au plus près des besoins, mais aussi de créer des intelligences artificielles ou des interfaces de réalité augmentée ou virtuelle qui viennent déjà seconder de nombreux corps de métiers dans des secteurs aussi essentiels que l’agriculture, l’éducation ou la santé. Le numérique est également ce socle d’intelligence qui porte les différentes composantes de la smart city, mais aussi les réseaux énergétiques de nouvelle génération, ou encore le pilotage en temps réel de la maison, qui seront autant de moyens d’aller vers davantage d’efficience et de sobriété énergétiques.
Prendre des précautions avec les effets présupposés du numérique sur l’environnement est d’autant plus important que les méthodes scientifiques de mesure des impacts directs, et plus encore des implications indirectes (les effets de rebond), ne sont pas encore des plus robustes.
En ce qui concerne la mesure des effets directs, l’industrie et les administrations focalisent sur les émissions de CO2, quand les scientifiques préconisent plutôt la méthode MIPS (material input per service unit) qui s’intéresse aux ressources qui entrent dans la composition d’un bien ou d’un service. Le MIPS permet, par exemple, de savoir qu’un ordinateur personnel de 2 kg aura mobilisé 22 kg de produits chimiques, 1,5 tonne d’eau et 240 kg de combustible. Un simple microprocesseur de 2 grammes aura, quant à lui, nécessité 32 kg de matières premières, soit un ratio vertigineux de 16 000/1 ! Si la méthode MIPS est probablement à privilégier, elle souffre néanmoins du flou et des imprécisions qui entourent les multiples données qu’il est nécessaire de mobiliser pour mener l’analyse à bien.
La mesure des effets indirects est une tâche encore plus délicate. Le télétravail illustre à lui seul toutes les difficultés de l’exercice. Un raisonnement simpliste consisterait à considérer que le télétravail (essentiellement permis par les solutions numériques mises à disposition des entreprises et des professionnels) est vertueux sur le plan environnemental à partir du moment où il économise des trajets de type domicile-travail réalisés via des modes de transport carbonés. Toutefois, ce serait ignorer l’ensemble des consommations additionnelles que le télétravail va engendrer dans le foyer des personnes concernées (éclairage, chauffage, consommation électrique, éventuellement des trajets supplémentaires pour faire des courses ou visiter une personne…). Or, non seulement ces consommations auraient pu être évitées, mais elles se réalisent de façons décentralisées quand la centralisation au sein du lieu de travail (qui ne disparaît pas pour autant) permet des économies d’échelle. On le comprend aisément à travers cet exemple : le bilan énergétique et environnemental de quelque chose d’aussi simple que le télétravail n’est pas simple à établir, en ce qu’il s’appuie sur des données parfois difficiles à observer, mais repose aussi sur des situations et des comportements individuels parfaitement hétérogènes.
Quand les entreprises de la tech alimentent un cercle vicieux de surconsommation - surproduction
Faute d’un consensus sur la méthode, et de pouvoir identifier, mesurer et anticiper l’ensemble des effets de rebond potentiels, il y a fort à parier que la controverse autour de l’impact environnemental du numérique n’est pas proche de s’estomper. Il ne faudrait pas, toutefois, que ces points aveugles n’en viennent à dédouaner les entreprises de la tech de leurs responsabilités vis-à-vis de la préservation de l’environnement. Car, une analyse froide des grands mouvements technologiques engagés depuis l’origine de la révolution numérique laisse à penser que la tech a d’abord été mise au service des marchés financiers plutôt qu’au service de l’humain et de l’environnement. L’explosion de la valorisation des géants du numérique, mais également la multiplication des licornes opérant dans le secteur du numérique, témoigne de marchés qui ont validé des stratégies orientées autour du renouvellement rapide des équipements numériques et la surconsommation de services numériques à fort potentiel addictif.
D’une part, les équipementiers sont incités à organiser l’obsolescence rapide des appareils (par exemple via l’optimisation logicielle orientée vers les dernières générations d’appareils, ou à travers des produits complémentaires uniquement compatibles avec les dernières générations d’appareils) pour pousser le marché mondial, qui est déjà largement couvert, à renouveler les équipements. Et tant pis si les modèles préexistants couvraient déjà parfaitement les besoins réels des consommateurs. Au-delà, nous assistons depuis plusieurs années à l’apparition de produits du quotidien aussi commun qu’un réfrigérateur ou une machine à café qui disposent désormais de "fonctions connectées". Le numérique fait alors office d’argument marketing pour susciter un acte d’achat, de nouveau sans jamais s’interroger si l’innovation numérique est de nature à répondre aux besoins réels des consommateurs. Dans un cas comme dans l’autre, la fonction de production – et de profit – de ces entreprises ne s’embarrasse guère des impacts environnementaux générés par leurs stratégies.
D’autre part, les entreprises développant des services numériques sont encouragées à promouvoir la technologie pour elle-même, sans toujours mesurer l’impact environnemental de leurs créations et s’assurer que celui-ci est en adéquation avec les apports économiques et sociaux de la technologie (que l’on songe à certaines applications de la blockchain pour s’en convaincre). Plus encore, elles sont incitées à créer des applications aussi addictives que possible.
Elles ont compris très tôt que leurs marchés se distinguent par deux caractéristiques structurelles majeures :
- ils sont soumis à de puissants effets de réseau, c’est-à-dire que les nouveaux utilisateurs s'abonnant à un produit ou à un service augmentent sa valeur et son utilité pour les utilisateurs actuels et futurs. Ces effets de réseau poussent à la concentration des utilisateurs (individus comme entreprises) autour des mêmes solutions qui deviennent, dès lors, dominantes. Si la plupart des entreprises et des professionnels du monde finissent par utiliser le réseau social LinkedIn, c’est précisément parce que la plupart des entreprises et des professionnels du monde l’utilisent ;
- ils sont également inscrits dans l’économie de l’attention, c’est-à-dire cette économie où les entreprises qui maximisent leur profit sont celles qui parviennent à attirer et retenir les utilisateurs durablement. Non seulement l’utilisation massive et soutenue de leurs services a des effets directs sur leur rentabilité (par les abonnements, l’exposition publicitaire et/ou l’exploitation des données des utilisateurs), mais a également des vertus indirectes puisqu’elle affaiblit les services concurrents. Quand vous êtes connectés à Instagram, vous n'êtes pas connectés en même temps à TikTok !
C’est la raison pour laquelle les développeurs de services numériques, en s’appuyant largement sur les neurosciences, codent leurs applications de telle manière qu’elles poussent les utilisateurs à y passer le plus de temps possible. Ludification, challenges, interfaçage stratégique, algorithmes apprenants et génération de dopamine, côté consommateurs, incitations monétaires côté créateurs de contenus, tous les coups sont permis pour remporter cette compétition pour capter le temps de cerveau disponible.
Nous le voyons à travers ces exemples : une grande part de l’écosystème du numérique repose sur des incitations à la surconsommation, ouvrant la voie par extension à une surproduction mortifère sur le plan environnemental et énergétique, en tout cas si l’on raisonne à périmètres technologique et réglementaire constants. Car, comme l’a démontré un collectif de chercheurs américains mené par Aditya Nair dans le cas particulier du streaming, c’est bien la surconsommation de contenus qui finit par anéantir les gains environnementaux initiaux liés à leur dématérialisation.
La nécessité d’une régulation éclairée et du retour de l'État stratège
Ce rapide tour d’horizon doit nous faire toucher du doigt toutes les limites d’une stratégie de réduction de l’empreinte environnementale du numérique qui ne reposerait que sur des efforts consentis par les utilisateurs. Certes, poursuivre la pédagogie autour de la compréhension de l’impact de nos usages numériques est indispensable. Mais ce n’est jamais là que la partie émergée d’un gigantesque iceberg. Nous ne résoudrons pas le problème uniquement en réduisant la qualité des vidéos, le temps d’écran ou le nombre de courriels et de likes émis quotidiennement. Pour réconcilier transitions numérique et écologique, nous avons besoin d’une réglementation éclairée et de la vision que seul un État stratège peut porter.
À ce sujet, la France et l’Union Européenne sont en pointe de la réflexion autour de l’impact environnemental du numérique. À travers la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui vise notamment à sensibiliser à l’obsolescence programmée et à la réparabilité des équipements, la loi REEN (Réduction de l’Empreinte Environnementale du numérique) qui promeut les datacenters et les réseaux les moins énergivores et ouvre la voie à l’encadrement des fournisseurs de services numériques les plus émetteurs de GES, ou encore les directives européennes "batteries" et "RhOS" (Restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment) qui restreignent les quantités de produits chimiques et de métaux dans les équipements numériques et incitent à leur recyclage, nous nous sommes munis d’un premier arsenal réglementaire précieux. Mais si cet arsenal entend lutter contre quelques-unes des inefficiences susmentionnées, son effectivité se mesurera à l’aune de notre capacité à contrôler les agissements des entreprises, et de prononcer des sanctions réellement dissuasives.
Une régulation éclairée du numérique doit, en effet, ambitionner d’envoyer les bons signaux aux acteurs du marché. Susciter les comportements vertueux en incitant, via un système de bonus/malus, à l’écoconception, à la recyclabilité, la durabilité, la modularité et la réparabilité des équipements (soutenir l’impression 3D peut y aider), ou encore à l’amélioration de l’efficacité énergétique des serveurs apparaît essentiel. Il faudra également sensibiliser les acteurs à l’importance d’œuvrer à un usage modéré de leurs services les plus énergivores et à se recentrer sur les innovations numériques qui répondent à des besoins fondamentaux. Or, comme nous l’avons vu, ces objectifs de modération se heurtent à la réalité des modèles d’affaires du numérique qui poussent naturellement à la surconsommation. C’est la raison pour laquelle il convient de ne pas écarter l’hypothèse d’une priorisation des usages, et donc, d’une remise en cause du principe de neutralité du net.
Au-delà, la réconciliation du capitalisme numérique et de la transition écologique appelle à un grand retour de l’État stratège. La France et l’Europe se doivent de définir une politique qui leur permette de se positionner (géo)stratégiquement entre l’Asie qui maîtrise l’amont de la chaîne de valeur (extraction / raffinage des métaux, production des équipements) et les États-Unis d’Amérique qui excellent dans les services et la valorisation de la donnée. Il en va de notre souveraineté autant que de nos perspectives de croissance économique. À cet effet, et alors que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) entrera en vigueur en 2026 ou 2027, il est urgent de se doter de capacités de production de semiconducteurs et de batteries en Europe, d’œuvrer à la mise en place d’une filière complète de recyclage des batteries et des équipements électroniques (de façon à moins dépendre des métaux étrangers au bilan énergétique désastreux), et d’accélérer le déploiement de capacités de production d’énergie décarbonée, ce qui aura la double vertu de verdir notre mix énergétique et de renforcer notre compétitivité. Compte tenu de l’ampleur des impacts (directs et indirects) du numérique sur l’environnement, nous ne ferons pas l’économie également d’une réflexion de fond visant à définir les communs, et à les faire observer sur la scène internationale.
Ces politiques, si elles sont menées tôt et de façon déterminée, pourraient s’avérer décisives pour nous éviter une situation désastreuse où la sobriété numérique s’imposerait brutalement à nous en raison de l’apparition de facteurs auto-limitants, tels que des ressources ou de l’énergie en quantité insuffisante pour répondre à nos besoins fondamentaux. L’inflation et les conflits d’usage qui résulteraient d’une telle situation entraîneraient des répercussions socio-économiques et politiques des plus néfastes. Se donner les moyens de déjouer un tel scénario, c’est ainsi œuvrer aujourd’hui en faveur de l’équité, du progrès et de la préservation de l’intérêt général de long terme.
Pour aller plus loin
La 11e édition du Printemps de l'économie (5-7 avril 2023) a pour thème "Action ! L'heure de l'engagement" et fait une large place aux questions autour de la transition écologique (voir le programme et les modalités d'inscription)